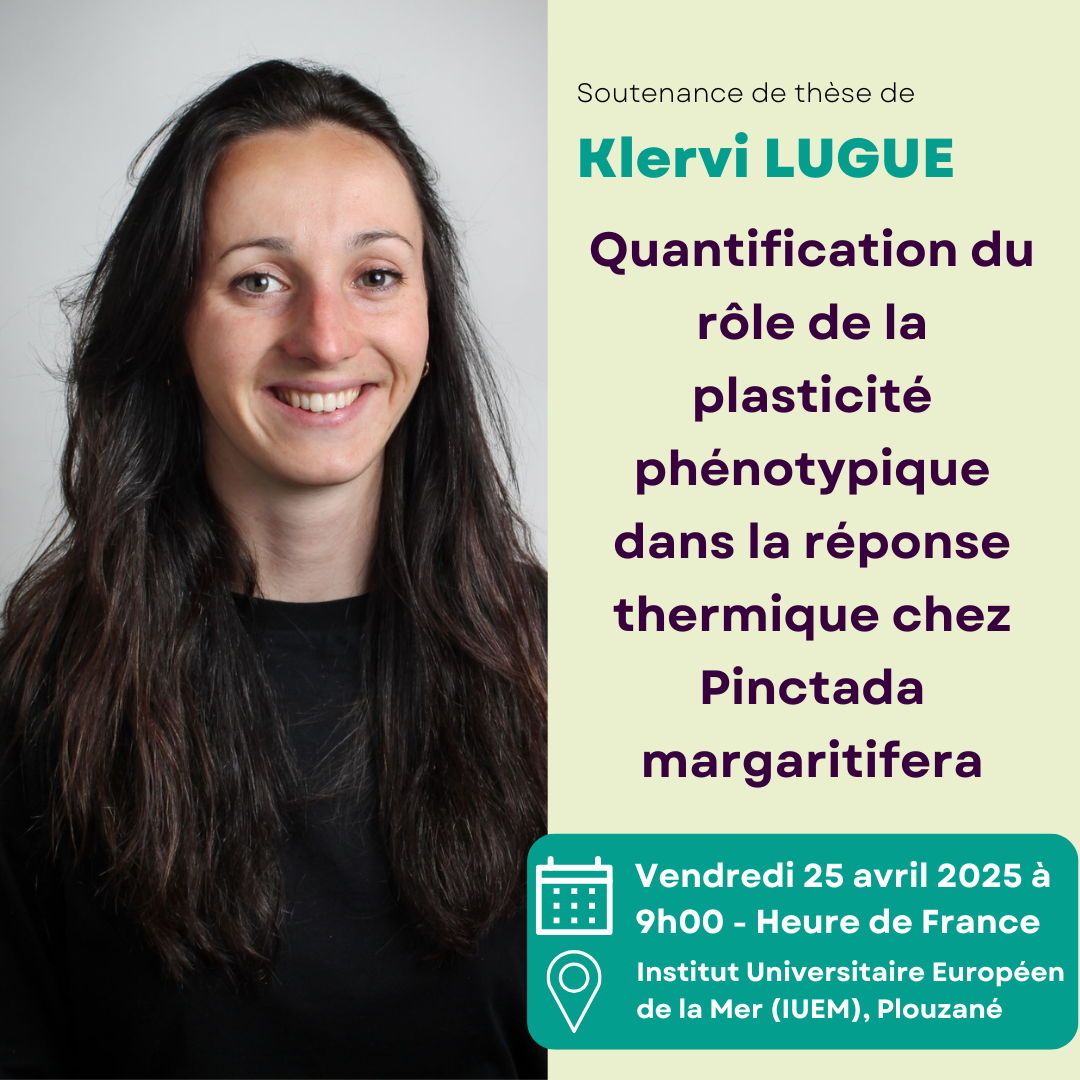Chaque année, les nouveaux records de températures océaniques, expliqués par le rythme accéléré du réchauffement climatique et la multiplication des événements climatiques extrêmes, précipitent notre planète dans des eaux inexplorées. Une question essentielle de la recherche sur le changement climatique est de comprendre comment les populations naturelles et les écosystèmes répondront aux divers scénarios du réchauffement climatique.
Cette problématique revêt une urgence particulière pour les espèces sténothermes, qui sont à la fois écologiquement et économiquement cruciales, comme l’huître perlière à lèvres noires, Pinctada margaritifera. Malgré les efforts scientifiques considérables investis dans l’étude de cette espèce au cours des dernières décennies, la question de sa sensibilité thermique reste encore largement sous-étudiée. Afin de contribuer à une meilleure prise de décision en matière de conservation et de gestion, cette thèse a adopté un cadre intégratif fondé sur le concept de thermal death time (TDT) et de norme de réaction physiologique, pour déterminer les limites thermiques de l’espèce tout au long de son ontogenèse. Nous formulons l’hypothèse que la plasticité phénotypique – capacité d’un génotype à exprimer une diversité de phénotypes en fonction des variations environnementales – pourrait constituer un mécanisme adaptatif clé face aux défis du changement climatique. En se fondant sur la caractérisation du paysage de tolérance thermique, des expériences en conditions contrôlées ont été menées pour quantifier la plasticité, tant au stade du naissain (heat-hardening), qu’au stade larvaire (plasticité développementale), sous des températures variables et écologiquement pertinentes.
Les résultats mettent en lumière, tout d’abord, les différences marquées de limites thermiques entre les divers stades de vie, les larves pélagiques étant particulièrement sensibles par rapport aux naissains. En outre, ils démontrent la capacité de l'espèce à moduler sa tolérance thermique en fonction de précédents événements de stress, tout en soulignant les limites de cette plasticité, qui ne saurait être considérée comme une « solution miracle » pour la conservation écologique ou l’amélioration de l’aquaculture. Ce travail fournit ainsi une base solide, tant sur le plan théorique, pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents aux réponses des espèces face aux changements globaux, que sur le plan pratique, en générant des données quantitatives sur la sensibilité et la résilience de l'espèce.